 Quelques réactions à chaud (bah, à peine tiède, avec une journée de retard) sur le texte de Marin à propos du livre numérique. Texte polémique, bien sûr, parce qu’il n’est pas d’emblée vendu à l’idée des ebooks/liseuses, parce qu’il tente de mettre l’idée du texte numérique à distance et d’en voir les tenants et aboutissants aujourd’hui.
Quelques réactions à chaud (bah, à peine tiède, avec une journée de retard) sur le texte de Marin à propos du livre numérique. Texte polémique, bien sûr, parce qu’il n’est pas d’emblée vendu à l’idée des ebooks/liseuses, parce qu’il tente de mettre l’idée du texte numérique à distance et d’en voir les tenants et aboutissants aujourd’hui.
Plusieurs propositions sont pertinentes (et elles étaient nécessaires); à titre d’exemples :
Malheureusement pour le livre électronique, il semble évident que la métaphore a constitué la matrice de l’invention de l’objet. Dès lors, c’est un objet que l’on a conçu, avant de penser un usage.
[Parlant de la liseuse, ici le cas du PRS 505 de Sony] En outre, l’objet est lent, très lent. Il est lent à mourir. Le paradoxe est fort : le livre est bien plus rapide !
Au delà de l’analyse (procès) de l’objet (et j’appuierai encore un peu plus sur le facteur confort de lecture), c’est la conception du livre qui me paraît un point déterminant ici. Marin le considère comme un point d’aveuglement dans la réflexion actuelle sur le texte numérique :
Et si on essayait de penser l’avenir de l’édition électronique sans se référer en permanence au bel objet qu’est le livre et aux nobles rayonnages des bibliothèques familiales ou des bibliothèques publiques ?
Je comprends et je souhaite contester à la fois. Le paradigme du livre est rigide et, jusqu’à un certain point, étouffant — parce qu’il balise la zone d’intervention de façon inutile, parce qu’il pourrait empêcher, de la sorte, to think outside of the box.
Mon malaise est toutefois double.
1. La série d’hypothèses proposée par Marin met en opposition le livre et l’édition électronique (« le livre est un optimum » et « l’édition électronique constituera un nouvel optimum »). Dans mon esprit, il n’y a que l’édition, et cette interface opère entre le caractère brut du texte, du langage et son incarnation dans un univers / lieu policé (polissé ?). Reste ensuite à envisager quelles sont les modalités de l’incarnation : livre, support périodique, affiche, pulp, tract, support électronique web / carnet / revue / hypermédiatique… L’optimum est donc à construire, comme le conclut lui-même Marin ; n’en sommes-nous pas à des prototypes intéressants dont le polissage reste encore à pousser plus avant, en fonction de nos usages, des possibilités offertes par une plateforme électronique, etc. ?
2. Les sept caractéristiques du texte numérique : ah…! Cette réflexion s’impose, pour sûr. Et c’est une façon de ne pas se laisser aveugler par les possibilités médiatiques actuelles. Mais toute tentative de saisie opère une sélection (et peut créer de l’insatisfaction…!). Ma gêne ne se situe pas tant dans le portrait du texte numérique proposé que dans le portrait du livre dessiné en creux par cette énumération. (Et je ne souhaite pas jouer ici le rôle du Néo-Luddite — pour le moins qu’on me connaisse, je n’en ai guère le profil…)
L’image souvent véhiculée du livre est celle d’une brique massive, statique et linéaire (c’est d’ailleurs le poids de l’histoire du livre qui se fait sentir par là, avec une conception du Beau liée à l’unité organique du contenu, au filé du discours, à l’empire de la rhétorique [il faut relire le Barthes pré-textualiste dans « Littérature et discontinu » à cet effet, Mobile de Butor étant un bel exemple du caractère potentiellement décoiffant du livre…]). On oublie deux faits à mon sens déterminants à propos du livre.
D’une part, il s’agit d’une ressource profondément tabulaire, qui combat intensément la linéarité traditionnelle du discours (table des matières, notes en bas de page, division en chapitres / parties, renvois internes à d’autres sections du livre, tableaux et images insérés — sans compter, du côté du lecteur, l’annotation par les lecteurs, les coins de page pliés, les paperoles glissées entre deux pages, les passages à relire en lien avec tel extrait). Tabularité fondamentale du substrat matériel du livre, avec des us et des conventions établis avec le temps… mais où est-elle dans cette définition du texte numérique ? Quelque part sous-entendue (le texte numérique est annotable ? hypertextuel ?), la tabularité du texte numérique renvoie-t-elle en fait à un archaïsme du texte matériellement incarné ? Ce serait donc postuler que le texte numérique, pour référer à ces liseuses qui permettent de grossir le caractère et qui de fait annulent le cadrage dans un format-page directement hérité de notre rapport avec le livre, est fondamentalement désincarné, que son inscription dans l’espace est en soi toujours contingente et qu’il refuse de se lier à toute spatialité un tant soit peu programmée en amont… Comment définir le travail éditorial, dans ce contexte ? Simplement une caution scientifique sur ce qui est diffusé ? Plutôt : il faut réinventer le rapport éditorial avec le texte, car il ne s’agit plus de monter un texte, mais de lui donner des attributs qui ne sont plus spatialement déterminés.
D’autre part, peindre un tel portrait du livre, c’est à l’évidence considérer (on l’oublie fâcheusement dans les débats actuels) que la lecture, comme acte, comme parcours, est infiniment active dans l’approche du livre. Recevant comme traces d’une tabularité des usages du livre toutes les marques du lecteur évoquées plus haut, nous devons reconnaître que l’activité du lecteur est très importante (en volume, en incidence sur l’interprétation) et qu’elle n’est pas subordonnée à la linéarité de la rhétorique du discours : interruptions, retours en arrière, lectures parallèles (dans le livre et dans d’autres ouvrages), relecture… En quelque sorte, le texte numérique se trouve à incarner (beau paradoxe…) les modes d’opération de la lecture (lier, déplacer vers une autre partie, annoter, indexer). C’est dire à quel point le texte numérique se construit depuis la lecture du livre et non contre elle (ou à l’écart d’elle).
* * *
À quoi tout cela nous avance-t-il ? Je crois que l’exercice de Marin est nécessaire, voire impératif dans la situation actuelle, car il remet sur la table la question non pas de la technologie, mais celle de l’interface, des usages, des modes d’appropriation. La frénésie technologique nous met souvent en situation de contemplation devant les innovations, mais trop peu nous engage dans une réflexion appliquée sur les usages, réflexion pouvant exercer une pression sur les fabricants des machins technologiques. Problèmes d’offre, de cadrage commercial (« avec ou sans premier livre lors de la vente ? »), de fonctionnalités : ce que relève Marin constitue sans nul doute un point de départ pour exercer cette pression sur les Sony, Amazon et autres fabricants de liseuses. Il faut voir là non pas du bashing contre les livres électroniques, mais une insatisfaction productive, qui nous empêche de s’installer dans le confort commercial des vendeurs de rêve.
(photo : « Warning! Do not read », YanivG, licence CC)
 Quelques réactions à chaud (bah, à peine tiède, avec une journée de retard) sur le
Quelques réactions à chaud (bah, à peine tiède, avec une journée de retard) sur le 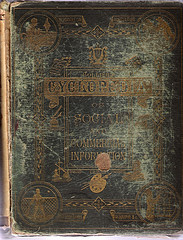
 de Roberto Busa sur l’index des oeuvres de St-Thomas d’Acquin, le domaine des médias interactifs s’est attardé au texte en tant que liste de mots (“words on a page”,
de Roberto Busa sur l’index des oeuvres de St-Thomas d’Acquin, le domaine des médias interactifs s’est attardé au texte en tant que liste de mots (“words on a page”,