
Pour certains, l’idée même des études littéraires reste fondamentalement bizarre. Comment enseigner la littérature, puisqu’on n’a qu’à ouvrir un roman et… lire ?
Les sciences humaines en général ont ce beau défi de faire valoir leur intérêt comme discipline, comme science… Beau défi ? Enfin, un défi constant, pas toujours joyeux, que celui d’expliquer le principe de la recherche en sciences impures à un collègue des sciences inhumaines. Pas de faits ? pas d’expériences pouvant être reproduites ? Elle est où, la recherche ?
Cette remise en question s’en prend même parfois à l’enseignement même de la littérature. Chose plus étonnante encore (les littéraires n’en sont pas à un paradoxe près), elle vient généralement de l’intérieur. À titre d’exemple, cet article de Bruce Fleming dans The Chronicle of Higher Education, forme de publicité pour son récent essai What Literary Studies Could Be, and What It is. Difficile d’imaginer une forme de bashing plus accomplie que celle-ci…
Students get something out of a book by reading it. Love of reading was, after all, what got most of us into this business to begin with. We are killing that experience with the discipline of literary studies […]
The major victory of professors of literature in the last half-century — the Great March from the New Criticism through structuralism, deconstruction, Foucauldianism, and multiculturalism — has been the invention and codification of a professionalized study of literature. We’ve made ourselves into a priestly caste: To understand literature, we tell students, you have to come to us. Yet professionalization is a pyrrhic victory: We’ve won the battle but
lost the war. We’ve turned revelation into drudgery, shut ourselves in airless rooms, and covered over the windows.
Je comprends tout à fait la position de Fleming : le jargonnage littéraire est rébarbatif et castre pour une part le plaisir de lecture ; il y a eu par le passé des abus notoires dans l’exercice de théorisation littéraire (où finalement la littérature était complètement larguée). Bref, comme dans tout, la modération a ses vertus.
* * *
Ce à quoi je m’oppose toutefois, c’est l’idéalisation extrême de la littérature comme nourriture de l’humanité.
The vast majority of students don’t even want to be professors: They’d like to get something from a book they can use in their lives outside the classroom. What right have we to forget them?
By watching Emma [Bovary]’s torture they may — just may — avoid living it out themselves. That is the kind of use to which literature, and its teaching in college, can legitimately be put.
Reading literature can change their lives — and ours. […] I, a straight white American male, can see myself in a black character or a female one, understand a point made by a dead Russian or a living Albanian, meditate on an abstract point made by an anonymous author. But that equally means that an X reader (say, black, gay, Albanian) need not read an X author (or character?) to get something from a work. Reading literature doesn’t require us to check our list of identifying adjectives to see if we’ll understand. Instead, we just have to dive in. Maybe
we’ll sink, maybe we’ll swim. Nobody can tell beforehand. That’s the beauty of books.
Interaction with literature can never be the basis of a systematic undertaking: It’s all too scattershot. All we can do is describe the sense of looking up from a page full of little black and white squiggles with the feeling that suddenly we understand our own lives, that names have been given to things that lacked them, and that the iron filings that hitherto were scattered about have configured into a clear pattern. Things are different now — somehow. Maybe that will cause us to act differently, maybe not.
Prêcher qu’il faut s’inspirer de la littérature afin de mieux comprendre l’humanité, d’y voir l’explication des maux humains, d’étudier la société à travers des œuvres qui nous offriraient un rayon-X sur un plateau d’argent… Il y a une psychologisation à outrance dans l’évaluation de la portée de la littérature. C’est comme si, en quelque sorte, Fleming demandait aux professeurs en art d’apprendre à leurs étudiants comment s’émouvoir devant un tableau de Van Gogh. Il y a une marge entre l’expérience personnelle d’appréciation et d’interprétation de l’œuvre d’art et la capacité de jeter un regard distant sur une production culturelle, d’en comprendre les tenants et aboutissants.
L’objet de la littérature est très certainement de se pencher sur l’humanité. L’objet des études littéraires est toutefois de voir pourquoi on en parle de cette façon, comment des écrivains y parviennent et quelles conditions socio-historiques permettent qu’on en parle… Les études littéraires ne sont pas la philosophie, ne sont pas la sociologie. Étudier des œuvres littéraires, c’est se demander : comment parvient-on à dire… (un sentiment, une représentation du monde / d’une société). C’est comprendre comment une œuvre parvient à construire et à transmettre un message ; c’est comprendre comment un lecteur (avec un bagage, des compétences et une inscription historique) parvient à recevoir ce message, à le lier à des lectures antérieures, à son monde. Étudier la littérature, c’est constamment faire le constat du miracle du langage : faire voir le monde, un monde, à l’aide de mots. S’il y a lieu d’apprendre à des étudiants à s’émouvoir, c’est qu’il faut susciter l’émerveillement devant la capacité de l’humain à dire, à transmettre, à construire.
En ce qui concerne les étudiants : c’est le vieil héritage classique que les professeurs de lettres tentent de leur léguer à travers leur parcours : une maîtrise du discours, une capacité de lecture. Former des gens qui sauront repérer et interpréter la manipulation du discours dans notre société, entraîner des gens à maîtriser une rhétorique non pas dans le cadre fermé de la loi et de la justice mais bien dans la vie quotidienne et dans l’art : c’est certainement une mission fondamentale. Dans notre société de la sur-information, la rhétorique sera notre meilleure arme. Si la lecture de Calvino, de Montaigne, de Poe et de Sterne amène les générations montantes à comprendre le pouvoir du langage, les professeurs d’études littéraires auront ainsi largement contribué au meilleur fonctionnement de la société de demain.
(photo : « Miti Mingi Secondary School, Kenya », teachandlearn, licence CC.
 Quelques réactions à chaud (bah, à peine tiède, avec une journée de retard) sur le
Quelques réactions à chaud (bah, à peine tiède, avec une journée de retard) sur le 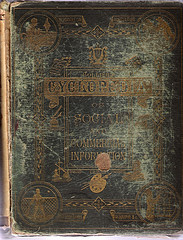
 Encore une fois, on remarque tout naïvement qu’une édition savante électronique procurerait un confort de lecture tellement plus grand aux différentes classes de lecteurs —
Encore une fois, on remarque tout naïvement qu’une édition savante électronique procurerait un confort de lecture tellement plus grand aux différentes classes de lecteurs — 