
Il y a longtemps que je me promettais cette réflexion ; voilà l’occasion de m’y coller. Le principe du droit d’auteur : on « respecte » la propriété intellectuelle en rétribuant l’auteur pour sa contribution. Si on cite, on honore la source (respect du droit moral) ; si on reproduit, on contribue à la vie financière de l’œuvre (respect d’un droit économique/patrimonial, à savoir le droit de reproduction)…
Tout à fait simple et on peut tenter de l’appliquer tel quel. Mais la pratique montre bien les limites (ou les zones floues) de ce principe. Je m’amuse ici à quelques scénarios hypothétiques : où se trouve la tolérance ? où tracer la délimitation entre infraction formelle et faute vénielle ? où faut-il prendre en compte les bénéfices secondaires (en visibilité, en publicité) au détriment de la lettre de la loi ?
Si le contexte universitaire, ici au Québec, est assez balisé en gestion de droits (via les politiques appliquées par Copibec), la zone prise en charge est celle du papier, dans une logique du papier. Qu’arrive-t-il quand on se retrouve dans une économie du savoir qui est numérique ?
Quelques cas d’application du droit d’auteur (et du droit de reproduction)
Cas 1. Un recueil numérique rassemblant des textes parus sur papier, pour fins d’enseignement. On peut bien rapailler les ISBN et ISSN des articles et extraits d’ouvrages pour déclarer les emprunts. Mais comment composer avec l’obligation de quantifier le nombre de copies réalisées ? Quand le service de reprographie de l’institution s’occupe de la production, on a une trace jugée fiable. Quid des pdf que l’on disséminerait à des étudiants ? On leur associe des DRM avec numéro de série ? Des fichiers chrono-dégradables ? Ou, complètement sous un autre regard : des portails in the cloud qui donneraient accès aux documents par des feuilleteuses ? Encore une fois, l’accès doit faire l’objet d’une transaction (sans compter le fait que l’accès internet doit être permanent en classe, que l’accès lui-même soit possible à distance). Mais quand on parle d’accès plutôt que de reproduction, avons-nous changé de paradigme ?
Cas 2. Un cours en ligne, accessible uniquement aux inscrits, qui reprend un article de journal entier. Même logique de déclaration du nombre d’inscrits, avec paiement à la pièce pour les inscrits (de quelle façon, opérationnellement, dites-moi) ? L’automatisme de l’obligation de paiement est retors : la plupart des journaux sont disponibles en version numérique pour les membres de la communauté universitaire via une banque de données à laquelle la bibliothèque est déjà abonnée — banque à laquelle tout membre de cette communauté peut accéder en autant qu’il soit branché au réseau informatique du campus. Donc la reproduction serait en soi illicite ? Faudrait-il privilégier un URL qui redirige sur l’article « original » (permettez-moi de m’étouffer), pour que la validation du branchement au réseau informatique autorise l’accès ? Mais comme de toute façon l’accès au cours en ligne est fonction de l’inscription aux crédits universitaires, on a un membre en bonne et due forme de la communauté universitaire — qu’il soit branché au réseau informatique ou pas. La reproduction paraît ici une vue de l’esprit : c’est l’accès qui est le rouage central… par un URL ou par une reprise des données numériques qui forment le texte, peu importe dans ce contexte précis : le résultat est le même (un usager validé peut lire un document numérique).
Cas 3. Dans un contexte quel qu’il soit (pas nécessairement académique) : reprise intégrale d’un texte (de numérique à numérique), que ce soit une page web, une entrée de blog, des ouvrages diffusés librement au format pdf. La référence au lieu d’origine (tousse tousse) est dûment signalée (et l’URL pointe vers la page). Pas de licence Creative Commons visible, pas d’interdiction formelle ou de copyright réservé non plus. Simple reprise, sans visée commerciale, sans transformation du texte. Répréhensible ?
Cas 4. Contexte général : un article de journal, version numérique, en accès restreint. Il a été publié. Dans ce mode d’accès, il est évidemment protégé. Mais qu’en penser, de cette protection, si on peut librement consulter les archives du journal en bibliothèque ? Que penser de cet accès protégé si quelqu’un épingle l’article sur un babillard en milieu de travail (que ce soit le journal découpé ou une sortie d’imprimante) ? si on lit l’article dans un journal abandonné dans le bus ou le métro ? si c’est une copie qu’une personne fait circuler à ses proches par courriel ? Souhaite-t-on vraiment, par cette protection, rendre le document le moins accessible possible, contrôler de façon rigide l’accès au document par cette barrière invisible ? Ce que l’on souhaite contrôler, c’est la lecture, la consommation (au sens économique de la lecture)… Et si là réside, dans la logique du papier, la différence entre les journaux et les livres (achat ou consultation pour les premiers, achat ou prêt pour les seconds), cette distinction semble s’effacer en contexte numérique — comment opérationnaliser le prêt en contexte numérique ? En prêtant le document avec son support (un reader, une tablette) ? Ou n’est-ce qu’une question d’accès ?
Cas 5. Plusieurs ressources en ligne tentent de protéger, de bloquer la diffusion de documents en utilisant des feuilleteuses ou des versions non imprimables de documents. Qu’en est-il des manoeuvres pour capturer, à des fins personnelles, ces ressources protégées (pour faciliter un accès au moment choisi, connexion internet ou pas) ? La copie d’écrans ou encore mieux la capture vidéo du contenu de l’écran, appliquée à des ressources comme les livres de GoogleBooks sous droits (héhé, G. et les droits d’auteur, autre débat…), sont-elles des pratiques illégales ? Probablement, mais que faire de l’exception de la copie privée ? Qui peut prétendre, de façon absolue, que toute copie privée est un viol à venir des conditions du droit de reproduction ?
En convoquant le langage de la protection et de la restriction pour gérer le droit d’auteur et le droit de reproduction, pose-t-on les questions de façon appropriée, lorsqu’on se place en contexte numérique ?
Lecture, accès, prêt, propriété, publication, reproduction…
En s’interrogeant sur la traduction du droit de reproduction des documents numériques, on voit très rapidement se profiler la tension entre une logique de propriété stricte (héritée du monde papier) et une logique d’accès : on ne possède pas les contenus que l’on peut consulter grâce à un abonnement, à un droit d’accès. Cette logique d’accès, les journaux l’ont vite comprise et mise à profit : en plaçant les archives numériques dans une voûte, à laquelle on accède après avoir montré patte blanche (celle qui est dénudée des sous qui s’y trouvaient), les journaux ont trouvé une manne (de remplacement, oui peut-être) dans cet accès à leurs vieux articles. C’est l’individualisation de la monétisation des archives : auparavant, les bibliothèques achetaient les microfilms d’archives, alors qu’aujourd’hui le bon citoyen doit souvent payer cet accès pour lui-même (oui, bon, peu nombreux étaient les possesseurs d’un lecteur de microfilms à la maison, ce qui peut expliquer les choses…).
Là où le bât blesse, c’est dans l’issue potentielle de cet accès. Il y a retour à l’enjeu de propriété (donc potentiellement illégitime) avec la transformation de cet accès en une manoeuvre de (re-)publication du document consulté. C’est dire à quel point, comme pour les pratiques des métiers régis par des ordres professionnels, l’acte de publier est un acte réservé… parce qu’il a des incidences économiques. On peut vendre une publication, on peut faire de l’argent au détriment de l’auteur (et l’invention du droit d’auteur, au XVIIIe siècle, ne visait pas autre chose : libérer les textes des rouages commerciaux des libraires-éditeurs, des imprimeurs, qui ne versaient pas de droits aux écrivains…).
Logique commerciale, donc, qui émerge dans le sillage de cette publication potentielle d’une personne accédant au document numérique. Mais encore là, héritage du papier : cette logique stricte de propriété est-elle parfaitement adaptée au monde numérique ? Il ne paraît pas anodin de se questionner sur la définition que l’on donne de la lecture — puisque toute lecture ouvre la porte à toute capture du texte, du document, de l’œuvre, vaut-il la peine de faire la distinction entre accès, prêt, copie, et ainsi donc de propriété, de reproduction, de publication ? À ce compte, aussi bien tirer la plug d’Internet — quelle engeance. Argument démagogique bien sûr… Mais où situer l’ancrage d’une réflexion renouvelée sur les droits en contexte numérique ?
Faut-il se référer à la position concurrente de cette logique de propriété, à savoir une logique de la dissémination ? La possibilité qu’un texte acquiert un statut viral entraîne une publicité potentielle et un effet de retour qui risquent souvent d’être plus grands que la situation économique liée au respect strict et immédiat du droit d’auteur (et donc de reproduction). C’est notamment l’esprit derrière des propositions comme Creative Commons (et son dérivé Scientific Commons), de même que Copyleft — toutes approches inscrites dans une culture du remix davantage que dans un culte de l’auteur.
Oeuvre ou contexte ?
Culture du remix, une culture abandonnant le lustre de l’œuvre. Lessig parle de l’opposition entre une Read/Only culture et une Read/Write culture. Abandon du prestige, de l’absolutisme, mais au profit de quoi ? L’objectif de Lessig est davantage de dénoncer les copyright wars, les aberrations de la réglementation. Ce qui m’intéresse davantage ici, c’est la transformation même de notre rapport avec l’œuvre. La cohabitation des versions concurrentes d’une œuvre sous différentes formes l’illustre bien : Philippe de Jonckheere reprend une portion de son journal pour le stabiliser chez publie.net ; Lawrence Lessig (et combien d’autres) publie simultanément un livre (papier, $$$) et sa version numérique (pdf en ligne, gratuit) ; certains articles de journaux disponibles sur le site du journal en même temps que son édition papier, en même temps que dans les banques de données, en même temps que dans les revues de presse gouvernementales ou celles d’agences de veille médiatique, sans oublier les lieux antérieurs de publication (pour les articles repiqués d’autres quotidiens à travers le monde) ou la version antérieure produite par l’agence de presse, à peine maquillée pour être publiée dans le journal… Lieu original de publication, hum ?
Qu’est-ce qui change, d’une version à l’autre ? Le contexte, sûrement : tel lieu d’apparition du texte est un gage de qualité des contenus diffusés ; tel autre lieu offre une fonction de filtre qui correspond mieux aux besoins du lecteur, de même que la version numérique libre d’accès assure un accès facile et partagé pour référence future. On insiste beaucoup ces temps-ci sur la fluidité des contenus, mais on n’a pas encore suffisamment réfléchi aux incidences de cette fluidité : la présence disséminée d’une œuvre, d’un texte est possible, même elle est chose courante. Il n’est pas contradictoire qu’un accès soit ici payant en échange d’une rapidité de mise en ligne, d’une certification de qualité ou d’une mise en contexte riche qui augmente la valeur du contenu que l’on consulte, et que cet accès soit là gratuit, en faveur d’une diffusion large, d’une mise à connaissance de ce contenu, d’un engagement de ce contenu dans une conversation qui lui donnera une visibilité et un impact considérablement plus grands que le seul accès payant. Virtualisée, l’œuvre connaît différentes incarnations — si c’était là un cliché du culte de l’avatar des années 80-90, il trouve assez bien à se réaliser… — et ne peut guère être saisie par une conception étroite de son existence. Si McLuhan disait que the medium is the message, il faudrait ajouter que le contexte co-construit ce message, plus que jamais.
Le contexte numérique (le numérique en soi et l’enjeu de contextualité tout juste établi) pose à l’évidence une diversité de questions à la conception du droit d’auteur et du droit de reproduction. Nous n’avons pas (encore) de réponses claires. Je ne suis certainement pas le premier à faire ce constat ; il m’apparaît toutefois primordial de le rappeler en cette période de transformation des usages, des pratiques. C’est donc le jugement, l’ouverture à la discussion qui s’impose en telle circonstance plutôt qu’une application stricte de lois placées dans l’impossibilité de prendre en compte des cas de figure sortant de leur cadre d’exercice. Cette attitude est nécessaire pour favoriser l’avancement de la réflexion sur le droit d’auteur et pour accroître la démocratisation du savoir.
(Note 1 : je ne suis pas un juriste. Mais je suis prêt à défendre que dans certains cas, un gros 1 + un gros 1 peuvent faire 3…)
(Note 2 : merci à Clément et à Hubert, pour échanges fructueux)
(photo : « Fuji Plagiarism », uzaigaijin, licence CC)

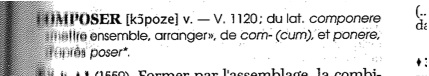
 Les morceaux (administration, ressources humaines, espaces de travail) tombent tranquillement en place. Ca démarre donc tout aussi tranquillement, mais là, décidément, ça va vers l’avant. Un centre de recherche sur la littérature et la culture au Québec prend conscience de ses fonds documentaires, des outils développés, des stocks de fiches / articles / références / grilles d’analyse entreposés par les chercheurs à Québec, à Montréal, dans des universités participantes. Trouver à saisir ces fonds documentaires, les structurer, les pérenniser, les diffuser. Voilà le (gigantesque) objectif que se fixe le
Les morceaux (administration, ressources humaines, espaces de travail) tombent tranquillement en place. Ca démarre donc tout aussi tranquillement, mais là, décidément, ça va vers l’avant. Un centre de recherche sur la littérature et la culture au Québec prend conscience de ses fonds documentaires, des outils développés, des stocks de fiches / articles / références / grilles d’analyse entreposés par les chercheurs à Québec, à Montréal, dans des universités participantes. Trouver à saisir ces fonds documentaires, les structurer, les pérenniser, les diffuser. Voilà le (gigantesque) objectif que se fixe le 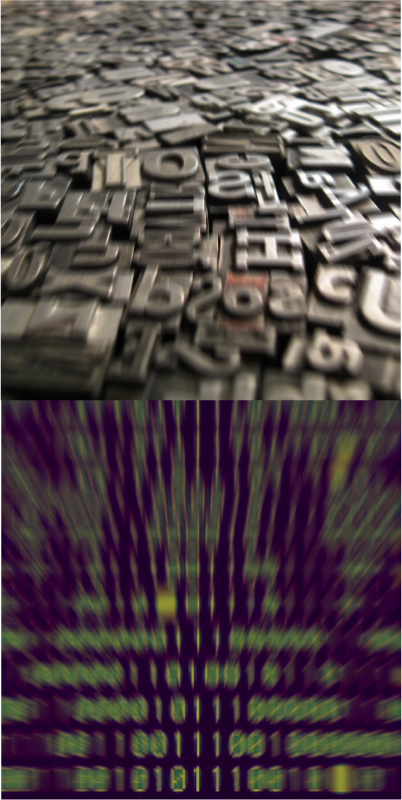 À Québec, le 26 février 2010, tenue d’une journée en formule bookcamp :
À Québec, le 26 février 2010, tenue d’une journée en formule bookcamp :