 Il en est toujours ainsi dans un champ en développement : les premiers acteurs du champ se réunissent pour brasser le modèle, pour en évaluer les extensions, pour imaginer sa portée potentielle. Pourtant, ces gens partagent souvent a priori peu de choses — horizons disciplinaires variés, objets distincts, méthodes spécifiques.
Il en est toujours ainsi dans un champ en développement : les premiers acteurs du champ se réunissent pour brasser le modèle, pour en évaluer les extensions, pour imaginer sa portée potentielle. Pourtant, ces gens partagent souvent a priori peu de choses — horizons disciplinaires variés, objets distincts, méthodes spécifiques.
Les orientations informant notre conception de ce qui peut être couvert par ce nouveau champ prennent une forme différente selon que l’on se trouve en milieu académique ou dans la sphère publique générale.
Le hype numérique, dans le champ académique, plus spécifiquement celui des sciences humaines, s’est cristallisé sous la forme très pointue des digital humanities (DH). Si l’expression est large, son incarnation recouvre souvent des pratiques très limitées (ou élues comme représentatives de l’approche). L’espace discursif, politique et médiatique est actuellement occupé par un volet très spécifique de l’usage des technologies dans la recherche en SHS : l’application d’approches quantitatives supportées par l’informatique. Les grands ensembles de données, le piochage dans ces marées binaires, les modalités de visualisation de requêtes : malgré les bonnes intentions exprimées par les digital humanists, ce ne sont souvent que le côté impressionnant et l’effet spontané sur le néophyte qui émergent, au détriment de l’analyse qui peut s’ensuivre (pourtant nécessaire : la visualisation, l’extraction de statistiques n’étant, faut-il le rappeler, qu’un moyen pour arriver à la « fin » que sont l’analyse et l’interprétation).
Du côté généraliste, c’est plutôt une conception mur à mur de la culture qui s’impose, une culture numérique pouvant décrire tout geste humainement posé en lien avec une modalité numérique. De l’interaction avec un distributeur de billets au vote électronique en passant par la sociabilité de la lecture, tout est culture. Soit. L’inconvénient est néanmoins de reléguer les pratiques culturelles au sens artistique/esthétique de la chose à un néant discursif, alors que tout est à construire dans ce champ de la culture /en contexte/ numérique.
Focus hyper spécialisé ou ballon gonflé jusqu’à ce qu’il crève : la situation reste peu confortable et mérite d’être conséquente des avancées actuelles dans une saisie plus fine, plus approfondie des enjeux que le numérique fait émerger. L’inconfort est le mien, et le portrait que je propose ici est conforme à mon positionnement dans le champ. Mon souhait est donc d’affirmer des positions qui puissent être différentes, mais nécessairement complémentaires. Trois axiomes, pour commencer à placer les choses.
1. Le retour à la culture
La graphie du titre de ce texte est indicative : je souhaite renforcer une lecture qui est d’emblée centrée sur la culture (dans un contexte qui est celui du numérique). S’intéresser à la transformation des productions culturelles lorsque leur création opère dans un monde numérique. Comment écrit-on de la fiction sur support numérique ? Les rhétoriques narrative et essayistique sont-elles influencées / bouleversées / mutées par la variable numérique ? Les enjeux de périodicité, de pérennité, de mise en réseau, d’archive modifient-ils notre conception du littéraire ? Ce sont là des questions fondamentales (et pourtant reconnues dans le champ littéraire conventionnel) ; pourquoi sont-elles généralement mises au rancart dans l’examen du devenir numérique de la littérature ?
Ce questionnement sur la culture, je l’étends également à la culture scientifique (cette double acception du terme « culture » est évidemment conséquente de mon intérêt pour la littérature mais aussi de mon métier de professeur-chercheur). Le bouleversement dans les outils de diffusion est perceptible, mais commence à peine à influencer notre conception du discours scientifique. On le perçoit bien : en mode numérique, il n’y a guère de différence entre un article (dans une revue savante éditée par un organisme qui s’assure de son évaluation par les pairs) et un livre (publié par un éditeur qui s’assure de sa qualité par une évaluation opérée par des pairs)… Brouillage des statuts, des zones autrefois réservées, il ne reste qu’une question de longueur… C’est sans parler du mélange entre revues, monographies, collectifs, publications d’actes en ligne, wikis, blogues individuels ou à plusieurs mains, rapports en ligne, outils web de transfert : la question de la légitimité du savoir scientifique est plus que jamais ébranlée, pour le mieux pourra-t-on conclure. L’apparition de projets de mise en valeur (comme le très très récent PressForward du CHNM) semble un bon signe. En pareil contexte : quelles conséquences sur la culture scientifique ce brouillage générique peut-il avoir ? Comment envisager la diffusion d’archives scientifiques, la mise en place de dépôts documentaires institutionnels et l’étalement du mandat des bibliothèques au-delà de leurs murs en regard des questions d’accès au savoir, de légitimation et même de propriété intellectuelle ?
2. Le numérique comme un moyen
Autant dans l’étude des productions culturelles que dans les propos sur la diffusion du savoir, la technologie tend à obnubiler les commentateurs. Les possibilités techniques, les technologies retenues accaparent le discours. Du côté des productions littéraires, ce sont les notions d’interactivité, de ludicité, d’hyperlien et de réseau qui prédominent, comme si l’écriture, au premier niveau, ne pouvait pas être profondément bouleversée par le contexte numérique. La diffusion du savoir, pour sa part, navigue entre les protocoles (OPDS, OAI, Onyx) et les formats (epub3, mobi, PDF/A) ; les questions de fond et d’écriture rencontrent une fin de non-recevoir.
Ce sont évidemment des éléments nécessaires au moment du développement de nouveaux usages. Mais ils absorbent la totalité des espaces de discussion et des occasions (scientifiques, financières, expérimentales).
Il paraît important, dans ce contexte, de ramener le numérique à son rôle de médiateur, d’interface (quel mot qui a vilainement vieilli), de moyen — moyen terme entre l’idée et sa diffusion, rouage au sein d’un processus infiniment plus complexe. S’il le faut, la parenthèse sur le numérique méritera d’être généralisée, pour relativiser les obsessions…
3. La lecture des paradigmes interpellés…
… et non l’aveuglement de la poudre aux yeux. Je suis sidéré par l’inégalité des vitesses dans les différentes sphères du monde discursif. Elsevier (pas le plus petit joueur dans le monde de la diffusion du savoir) clame sans vergogne qu’il met au monde « the article of the future » : des revues savantes qui intègrent des graphiques, des visionneuses d’images et quelques animations. Bravo ! (…?) Mais deux observations corollaires. A. Quel retard les éditeurs scientifiques ont-ils pris par rapport au web, par rapport aux éditeurs généralistes de contenu numérique : ces usages de la mise en forme des données sont terriblement courants sur le web, au point de dire que les éditeurs scientifiques ont facilement 5 ans de retard sur ce qu’offre la technologie. B. Malgré l’implémentation de ces possibilités, on note aisément que le discours scientifique est toujours aussi lourd et cadenassé dans les mêmes modèles discursifs. L’article maintient les sous-parties attendues dans ce genre de texte depuis des dizaines d’années (voir entre autres en psychologie, en sciences sociales) ; la monographie est un schéma rhétorique convenu et repris.
Quelle réinvention de ce modèle, par exemple, est-il possible d’envisager ? Pourquoi maintenir l’idée de la monographie (lente, synthétique, verbeuse) contre celle de l’article (en phase avec l’actualité, en lien avec une problématique ou un objet restreint, rebondissant sur le discours critique antérieur) ?
Sur ce même paramètre de la longueur : le web tend-il à bousculer la scission entre le roman et le texte bref, entre le texte unitaire et l’ensemble de fragments, entre le texte fini et le work-in-progress ? Qu’est-ce que la littérature peut dire du monde lorsque les mots se trouvent en situation de précarité, de fausse pérennité (car la vraie pérennité, en contexte numérique, est d’abord un enjeu de visibilité) ?
Cette lecture, enfin, peut-elle se faire, aujourd’hui, sans recours à l’expérimentation elle-même ? Doit-on attendre l’invention par autrui de nouveaux modèles discursifs (littéraires, scientifiques) ou le tissage intime entre création et critique n’implique-t-il pas d’y participer activement pour mieux revenir, en position d’analyse, sur les propositions ainsi formulées ?
* * *
J’entendais encore ce matin un politicien affirmer la nécessité d’ «investir dans la culture ». Cette approche mathématique m’exaspère.
Il faut affirmer la culture, la défendre, la produire. Qu’elle soit nationale ou numérique, la culture mérite qu’on s’y investisse.
(photo : la table des bidouilleurs, La fabrique du numérique, février 2010)
 Il en est toujours ainsi dans un champ en développement : les premiers acteurs du champ se réunissent pour brasser le modèle, pour en évaluer les extensions, pour imaginer sa portée potentielle. Pourtant, ces gens partagent souvent a priori peu de choses — horizons disciplinaires variés, objets distincts, méthodes spécifiques.
Il en est toujours ainsi dans un champ en développement : les premiers acteurs du champ se réunissent pour brasser le modèle, pour en évaluer les extensions, pour imaginer sa portée potentielle. Pourtant, ces gens partagent souvent a priori peu de choses — horizons disciplinaires variés, objets distincts, méthodes spécifiques. Je ne voulais pas manquer cet anniversaire. Par nostalgie un peu, par acquit de conscience aussi, par souci de marquer le temps qui a passé. Il y a un an se tenait à Québec la
Je ne voulais pas manquer cet anniversaire. Par nostalgie un peu, par acquit de conscience aussi, par souci de marquer le temps qui a passé. Il y a un an se tenait à Québec la 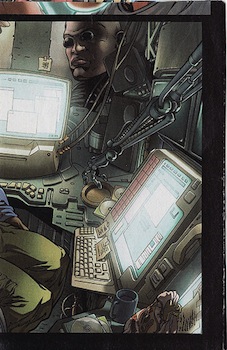 C’est une réflexion que je mène assez intensément — mais intuitivement — ces jours-ci… Comment organiser mes activités de lecture? Comment gérer les supports, les annotations, les références ? J’en avais déjà bien assez avec mes propres remises en question. Et voilà Marin Dacos qui me lance, via twitter, sur l’idée d’expliquer comment je lis (il parlait de mes usages réels de lecture numérique). Belle invitation, bel exercice…
C’est une réflexion que je mène assez intensément — mais intuitivement — ces jours-ci… Comment organiser mes activités de lecture? Comment gérer les supports, les annotations, les références ? J’en avais déjà bien assez avec mes propres remises en question. Et voilà Marin Dacos qui me lance, via twitter, sur l’idée d’expliquer comment je lis (il parlait de mes usages réels de lecture numérique). Belle invitation, bel exercice… Étrange sentiment, tout de même.
Étrange sentiment, tout de même.